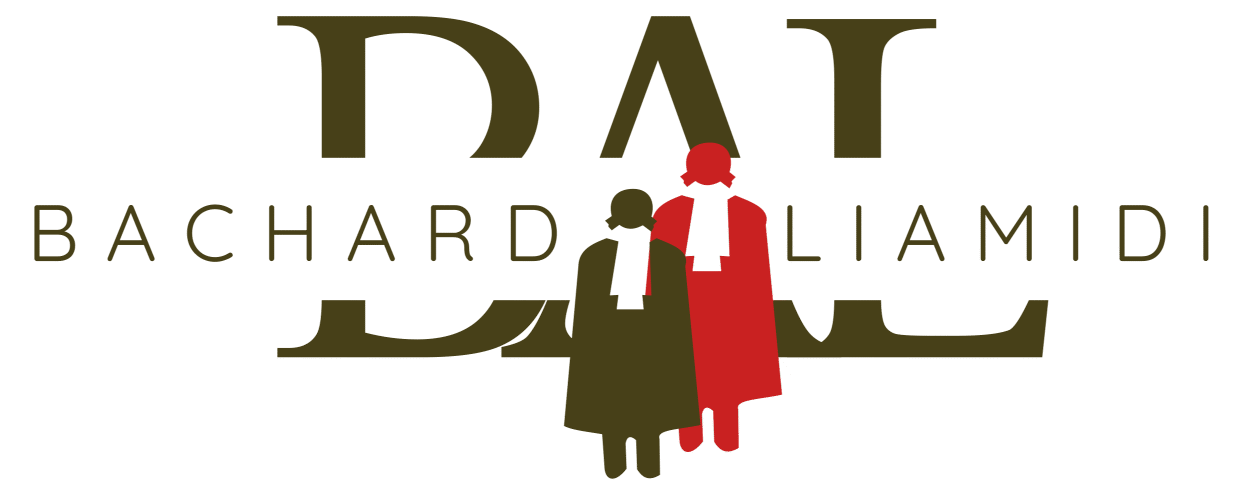Par Maître Bachard LIAMIDI – Docteur en Droit privé; Avocat au Barreau du Bénin
Introduction
L’Etat de droit démocratique est la forme d’organisation politique la plus aboutie. Il allie tout à la fois, la limitation du pouvoir, en ce que chaque organe du pouvoir exerce sa compétence dans le respect des procédures dédiées, la hiérarchisation des actes du pouvoir aux fins d’en faciliter le contrôle, par rapports à la norme fondamentale et enfin la possibilité offerte aux citoyens de s’adresser à un juge pour faire valoir leurs prétentions y compris, contre l’Etat lui-même.
Cette architecture de l’Etat de droit démocratique est celle qui aurait inspiré le constituant béninois du 11 décembre 1990. Pour preuve, si les articles 125 et 127 de la LOI N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin assure successivement le principe de la séparation des pouvoirs et le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’article 126 al. 2 précise que : « les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leur fonction, qu’à l’autorité de la loi ».
Dans un pareil contexte, l’épanouissement des libertés publiques est assuré par la toute-puissance de « la règle de droit » dont la normativité protectrice est garantie sans être fermée au contrôle du juge qui a pour principal interlocuteur l’avocat, un veilleur et gardien par excellence des libertés individuelles et collectives.
L’intérêt pratique d’une réflexion sur « l’avocat et la défense des libertés individuelles et collectives au Bénin » est donc bien mesuré au regard de ses enjeux pour la démocratie et le renforcement de l’Etat de droit.
Selon le Doyen G. CORNU, l’avocat désigne « l’auxiliaire de justice qui fait profession de donner des consultations, rédiger des actes et défendre, devant les juridictions, les intérêts de ceux qui lui confient leur cause, et dont la mission comprend l’assistance (conseil, actes, plaidoiries) et/ou la représentation ».
Le statut de l’avocat en raison de sa mission et de son rôle dans la cité, lui confère des prérogatives attachées à sa qualité d’auxiliaire de justice et des obligations professionnelles vis-à-vis des personnes qu’il représente, assiste et dont il assure la défense des intérêts en justice et de l’Ordre auquel il appartient. En ce qui concerne les obligations professionnelles qui incombent à l’avocat dont le manquement est susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, elles se déclinent en deux grandes catégories notamment les obligations liées à l’image de la profession (obligations découlant du serment , obligations liées à l’exercice de la profession) et les obligations vis-à-vis de ses clients (obligation d’information et de conseil, obligation de compétence ou obligation de diligence, obligation au secret professionnel). S’agissant des prérogatives qui sont attachées à sa qualité d’auxiliaire de justice, vient en premier rang, son droit au secret professionnel, qui est un véritable bouclier pour la protection de l’activité professionnelle de l’avocat mis en cause à l’occasion des perquisitions, saisies et visites domiciliaires dont il peut faire l’objet, aussi bien en son cabinet qu’a son domicile. Il en va de même pour les situations qui imposent sa mise sur écoute téléphonique. Aussi, faut-il préciser qu’il bénéficie d’une réelle immunité de parole tant que ses propos ou écrits ne s’avèrent étrangers à la cause entendue et n’excédent les limites des droits de la défense.
La définition du terme « avocat » et les précisions apportées relativement à son statut présentent un lien de corrélation avec le mot « défense » qui doit être entendu ici comme l’« action de se défendre en justice, de faire valoir devant le juge ses droits ou ses intérêts (comme demandeur ou défendeur) soit par soi-même (seul ou avec assistance), soit par représentation selon ce que la loi permet ou ordonne ».
Dans la perspective des clarifications amorcées, il convient tout aussi de préciser les contours du terme « libertés ». En effet, on entend par « libertés », sous l’éclairage du Professeur J. RIVERO, « des pouvoirs d’autodétermination consacrés par le droit positif ». Ainsi, ces libertés peuvent être classées selon différents critères qui privilégient, soit leur titulaire (personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public), soit leur objet (liberté d’association, liberté de la presse…), soit leur mode d’exercice (libertés individuelles ou libertés collectives).
Les expressions « individuelles » et « collectives » viennent donc tout simplement indiquer le mode d’exercice de la liberté susceptible d’être défendue en justice par un avocat.
Face à toutes ces libertés aussi bien fondamentales que publiques, d’exercice tant individuel que collectif et, susceptibles ou non de restrictions dans les situations précises déterminées par la loi, quels les rôles et les missions pour l’avocat dans la perspective de la défense desdites libertés ?
Le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel offre une hypothèse assez intéressante pour répondre aux préoccupations essentielles sus énoncées. Selon ce dernier, « si l’avocat a pour mission de protéger, c’est nécessairement contre quelqu’un ou contre quelque chose. Et s’il en a l’obligation, c’est que la seule affirmation du caractère fondamental d’un droit ne suffit pas à le rendre sacré, intouchable. Ce rapport trinitaire implique le conflit : dans une société rêvée, les personnes devraient être premières, le pouvoir se bornant à garantir l’exercice de leurs droits et de leurs libertés et à sanctionner au nom du droit les entraves à ces libertés ou les abus commis dans leur exercice. L’avocat, dans cette société idéale, serait le garant de ce que les juges respectent la procédure tout en portant vers eux la parole de leurs clients ».
Plusieurs situations contemporaines marquantes méritent d’être reconsidérées pour servir de cadre à la réflexion entreprise. Il est encore vivace dans les esprits certaines décisions graves attentatoires aux libertés collectives prises par le Gouvernement du Président Patrice TALON, en l’occurrence l’interdiction des prières dans les rues courant janvier 2017, la liberté de culte, une liberté d’exercice collective s’est trouvée en conflit avec la politique du gouvernement qui fait écho dans cette sentence du Garde des Sceaux d’alors Professeur J. DJOGBENOU « Le gouvernement considère que nos rues ne peuvent plus être exposées à l’expression de la foi, quelles que soient les religions ».
Un peu plus tôt, le conseil des ministres du 05 octobre 2016 accouche entre autres du décret portant interdiction d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin. Une liberté d’exercice collectif, la liberté d’association a été restreinte pour des raisons essentiellement sécuritaires à en croire les autorités publiques.
Par ailleurs, nul ne saurait ignorer ce que représente le droit de propriété et les droits voisins pour les béninois, dans leurs large majorité. Les contentieux domaniaux sont importants et rébarbatifs ce qui pourrait rendre les procédures d’expropriations pour cause d’utilité publique difficile, si les règles de bases sont foulées aux pieds. Il tombe fort à propos de relever si besoin en est le sort fait aux personnes expropriées pour cause d’utilité publique dans la zone Aéroportuaire de Glo Djigbé. Aussi, est-il nécessaire de s’intéresser aux problèmes qui naissent des contrats de bail civils et commerciaux en l’occurrence le contentieux de la possession.
Mieux, en matière répressive les espaces de liberté connaissent un recul significatif, la procédure devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme est décriée par les avocats, en raison des restrictions apportées à la liberté de la défense. Le recours aux mesures privatives de libertés est systématique, la liberté est l’exception, la détention la règle. Les voies de recours aux fins d’une mise en liberté provisoire prospèrent très rarement. Ces champs d’analyses pré-identifiés sont fondamentalement « conflictogène », car ils opposent le citoyen à l’Etat qui lui-même doit soumission aux règles qu’il s’est prescrit.
Il semble donc cohérent d’envisager dans un premier temps l’étendu du rôle de l’avocat dans la défense des libertés individuelles et collectives (I) et en second lieu les limites au rôle de l’avocat dans la défense desdites libertés (II).
- L’étendu du rôle de l’avocat dans la défense des libertés individuelles et collectives
L’étendu du rôle de l’avocat dans la défense des libertés individuelles et collectives est fonction de la juridiction au-devant de laquelle le contentieux né est porté et de la stratégie que ce dernier entend mettre en œuvre, pour assurer au mieux la défense des intérêts des personnes qui l’ont constitué. Cette équation ne peut être résolue qu’en tenant compte des faits rapportés, la nature du droit revendiqué ou contesté et la finalité recherchée.
Dans tous les cas, le recours au juge constitutionnel béninois s’impose comme la voie royale à emprunter en raison de sa spécificité, sa célérité et de l’efficacité plus ou moins discutée de ses décisions (A), toute chose qui n’est point incompatible avec la saisine du juge judiciaire dont l’impérium suffit à faire la différence (B).
- Le recours au juge constitutionnel
Pour revendiquer une liberté d’exercice individuelle et collective reconnue par la Constitution, le requérant assisté de son conseil peut saisir le juge constitutionnel par la voie d’action qui apparait comme la plus prépondérante (1) ou la voie d’exception dont la mise en œuvre n’est pas toujours aisée (2).
- La prépondérance de la voie d’action
Le contentieux constitutionnel au Bénin est suffisamment ouvert pour intégrer le contrôle de légalité des actes réglementaires. En effet, la Cour constitutionnelle du Bénin est fondée à se « prononcer d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censé porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ».
Il est reconnu à tous les citoyens le pouvoir de déférer à la censure du juge constitutionnel « les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels ». En cette occurrence, le juge constitutionnel se prononce nécessairement sur « la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux ».
A l’analyse, ces diverses dispositions constitutionnelles donnent pleine compétence à la Cour, sans être juge de la légalité des actes administratifs de pouvoir connaitre des griefs tirés de la violation des droits et libertés. C’est ainsi qu’à l’occasion, le juge constitutionnel béninois a décidé qu’un arrêté municipal interdisant une marche, en raison de risques de troubles à l’ordre public, ne portait pas atteinte à la liberté d’association consacrée à l’article 25 de la Constitution. Aussi doit-il être rappelé que dans le contentieux de l’interdiction des mouvements estudiantins, le juge constitutionnel sur saisine est parvenu à la conclusion selon laquelle « la décision du Conseil des ministres du 05 octobre 2016 et le décret n°2016-616 du 05 octobre 2016 portant interdictions d’activités des fédérations, unions, associations ou organisations faîtières d’étudiants dans toutes les Universités nationales du Bénin sont contraires à la Constitution et donc nuls et non avenus » en ce qu’ils violent les dispositions de l’article 125 de la Constitution.
En droit processuel béninois, rien ne s’oppose à la saisine simultanée des juges de l’ordre judiciaires et du juge constitutionnel. Cette situation intervient dans bien des cas, étant donné que la Constitution du 11 décembre 1990 n’organise pas une certaine articulation entre les différents types de juridictions en matière de protection des droits fondamentaux.
En dehors des cas d’auto-saisine de la Cour constitutionnelle, il est courant que les justiciables initient leurs recours aussi bien devant les juridictions ordinaires que devant la Cour constitutionnelle, toute action visant à tirer le meilleur bénéfice du contentieux constitutionnel, en cas de succès pour lier le juge judiciaire. Il se crée en cette occasion une sorte d’autorité du jugé au constitutionnel sur les juridictions de l’ordre judiciaire ou, la règle de la succombance d’une décision rendue par les juridictions ordinaires dès qu’elle est déclarée contraire à la Constitution.
A titre illustratif, la Cour constitutionnelle, sur saisine directe, a apprécié la conformité d’un arrêt rendu par la Cour suprême en application du droit coutumier. En effet, dans cette affaire qui a accouché d’une décision que l’on pourrait qualifier de décision majeure, le requérant avait été débouté en première instance et en appel dans une affaire domaniale. Relativement à la question en débat les juges du fond avaient estimé que le domaine dont le requérant réclamait l’héritage ne pouvaient avoir été acquis par ses ancêtres qui, en qualité d’esclaves, ne jouissaient pas du droit d’accès à la propriété.
Se fondant sur sa propre jurisprudence qui avait établi que le droit coutumier ne pouvait « servir de base légale à une décision judiciaire », la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution, l’arrêt no 13/CJ-CT du 24 novembre 2006 de la chambre judiciaire de la Cour Suprême en ce qu’il porte atteinte à la dignité humaine.
- Les contraintes de la voie d’exception
Le recours au juge constitutionnel par voie d’exception n’est envisageable que par le truchement de l’exception d’inconstitutionnalité. Au sens de la doctrine, l’exception d’inconstitutionnalité désigne un « incident de procédure dans le cadre d’un procès, à l’occasion duquel un justiciable met en cause la conformité d’une loi à la Constitution. Après en avoir examiné le caractère sérieux, le juge, saisi au fond, est appelé soit à statuer lui-même, soit à en renvoyer l’examen à la Cour constitutionnelle, au titre d’une question préjudicielle ».
Au regard de cette définition, bien que le constituant béninois ait opté pour le terme « exception d’inconstitutionnalité, le contenu de l’article 122 de la Constitution du 11 décembre 1990 renvoie à une question préjudicielle.
En effet, l’article 122 sus évoqué dispose : « tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours ».
De l’avis même du juge constitutionnel relativement à l’objet de cette procédure, il est clairement établi que « l’exception d’inconstitutionnalité doit porter sur la question de conformité à la Constitution d’une loi applicable au procès en cours ».
Aussi faut-il préciser que le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en son article 39 stipule que l’exception « peut être soulevé à tout moment de la procédure devant la juridiction concernée ».
Les contraintes de cette procédure sont telles qu’en près de trente ans de pratique de l’exception d’inconstitutionnalité, le juge constitutionnel a rendu plus de deux cents décisions sur la question et dont une seule à prospérer. Ces statistiques peu glorieuses s’expliquent par le recours à cette procédure à des fins dilatoire et la mauvaise interprétation du droit d’option qui rend inopérant et irrecevable une saisine simultanée par voie d’action et d’exception.
Quels recours pour la défense des libertés individuelles et collectives devant les juges judiciaires et administratifs ?
- Le recours au juge judiciaire ou administratif
La défense des libertés individuelles et collectives par l’avocat se mène également devant les juges administratifs et judiciaires dont la saisine s’apprécie en fonction de la nature du litige à résoudre.
Une analyse casuistique fondée sur la récurrence de certains types de contentieux, justifie l’intérêt marqué non seulement pour le contentieux de l’excès de pouvoir, face à une mesure d’interdiction (1) mais aussi pour le contentieux de la propriété et de la possession face à tous périls (2)
- Le contentieux de l’excès de pouvoir face à une mesure d’interdiction
La compétence des juridictions statuant en matière administrative est établie pour connaitre du contentieux de tous les actes administratifs émanant de toutes les autorités administratives de son ressort.
Dans l’hypothèse où certaines autorités administratives prennent des actes administratifs manifestement attentatoires à la liberté de manifestation ou d’association, au sens de l’article 818 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiée et complétée par la loi n° …… portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, plusieurs actions ou recours peuvent être envisagés :
- Recours en annulation pour excès de pouvoirs des décisions des autorités administratives ;
- Recours en interprétation des actes des mêmes autorités ;
- Recours de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public, sauf exceptions prévues par la loi.
La recevabilité Pour être recevable dans son recours, le requérant doit observer :
Art. 827 – Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée. Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de deux (02) mois par l’autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet. Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux (02) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux (02) mois susmentionnés. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (02) mois prévu à l’alinéa précédent ».
En matière de recours pour excès de pouvoir, la chambre administrative de la Cour suprême du Bénin a opéré un revirement spectaculaire de jurisprudence. Il paraît important de restituer ici les grandes lignes de ce grand arrêt de la Cour suprême :
« Considérant que l’alinéa 3 de l’article 827 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose, « avant de se pourvoir contre toute décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision » ; qu’il ressort de cet article que le législateur a entendu exiger de tout requérant, la présentation d’un recours hiérarchique ou gracieux, faisant de ce recours administratif, un préalable obligatoire à la saisine du juge ; Considérant que le caractère obligatoire du recours préalable vise à instituer un préliminaire de conciliation en mettant l’administration dans les conditions de connaître des griefs qui lui sont reprochés pour réexaminer le cas échant, sa position ou sa décision ; que le recours préalable constitue une instance fonctionnellement différente et indépendante du recours juridictionnel et le siège du réexamen de la décision administrative initiale ; que procédant au réexamen de la décision initiale, c’est la décision prise sur le recours administratif préalable qui arrête définitivement la position de l’administration ; qu’ainsi, le recours administratif préalable obligatoire…, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître, le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration ; qu’il s’ensuit que la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue nécessairement à la décision initiale est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité ; qu’au surplus, l’article 827 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, par suite, dispose que, dans le cas du silence gardé par l’autorité compétente pendant plus de deux mois, « le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux (02) mois à compter du jour d’expiration de la période de deux (02) mois susmentionnée » ; qu’ainsi libellé, cet article confirme que le recours juridictionnel doit être formé contre la décision implicite, et non contre la décision initiale ; qu’à plus forte raison, le recours juridictionnel doit être formé contre la décision explicite…que DJIGLA Mathias, au lieu de former son recours contre cette décision explicite, a formé son recours contre les arrêtés préfectoraux, donc la décision initiale ; … ».
Sous le rapport de la Conseillère Dandi GNAMOU, la Cour suprême pose et impose le droit applicable désormais en la matière : le recours juridictionnel doit être adressé non pas contre l’acte administratif initialement contesté mais contre la réponse implicite ou explicite donnée par l’administration au recours administratif préalable et obligatoire. Cette réponse est la dernière position de l’administration et cristallise le contentieux juridictionnel.
La cristallisation des moyens En vertu de la jurisprudence INTERCOPIE, le requérant n’a pas le droit de développer après le délai de recours contentieux un moyen qui procède d’une cause juridique distincte de la cause juridique à laquelle se rattache les moyens développés dans le délai de recours contentieux
Pour résumer, le requérant qui invoque uniquement des moyens de légalité interne dans le délai de recours contentieux ne sera plus en mesure d’invoquer après le délai de recours contentieux des moyens de légalité externe. C’est pour cette raison, qu’il faut toujours dans ses écritures initiales développer des moyens de légalité interne et externe durant le délai de recours contentieux afin d’avoir une marge d’action plus élargie, après l’expiration du délai de recours contentieux.
Il est cependant à noter, que les moyens d’ordre public peuvent tout de même, être soulevés. Ainsi, ils sont la seule et unique dérogation à la jurisprudence INTERCOPIE.
- Le contentieux de la propriété et droits voisins face au péril
Au Bénin, la propriété immobilière est fondamentalement source de conflit. Si le contentieux de la propriété immobilière entre particuliers est important, l’expropriation pour cause d’utilité publique l’est davantage, dès lors qu’elle oppose les pouvoirs publics à ces derniers (a), ce qui permet d’appréhender un autre type de conflit en l’occurrence, les troubles à la possession (b).
- L’expropriation pour cause d’utilité publique
Notion L’expropriation pour cause d’utilité publique désigne « une procédure permettant à une personne publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public) de contraindre une personne privée à lui céder un bien immobilier ou des droits réels immobiliers, dans un but d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Dans certains cas, elle peut être mise en œuvre au profit de personnes juridiques privées en vue de la réalisation d’un objectif d’utilité publique. Dans tous les cas, la déclaration d’utilité publique doit émaner d’une autorité de l’Etat ».
Il s’agit d’une procédure qui repose sur des fondements constitutionnel et légal. Au sens de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin « […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement ». Mieux le législateur béninois dispose que « l’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels pour cause d’utilité publique s’opère, à défaut d’accord amiable, par décision de justice et contre le paiement d’un juste et préalable dédommagement ».
Compétence d’attribution les tribunaux judiciaires sont les gardiens de la propriété privée immobilière et en vertu de ce principe, ils sont compétents pour connaitre de l’action en indemnité d’expropriation irrégulière exercée par une personne dépossédée de son immeuble, pour cause d’utilité publique.
Ainsi, les tribunaux judiciaires peuvent par exception se prononcer sur la légalité des actes administratifs, même règlementaires, sans en faire une question préjudicielle à trancher par les juridictions administratives, lorsqu’ils servent de base à certaines mesures portant une grave atteinte au droit de propriété immobilière et entrainant une emprise de l’administration sur la parcelle dont le propriétaire est dépossédé.
- Les troubles de la possession
Le trouble peut être défini comme « tout fait matériel ou tout acte juridique qui, soit directement et par lui-même, soit indirectement et par voie de conséquence, constitue ou implique une prétention contraire à la possession d’autrui ».
Avec l’avènement de la Loi n° 2008-07 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi 2016-16, les actions possessoires, moyens procéduraux de base pour faire cesser les troubles à la possession, se sont vues remplacées par la procédure de référé prévue à l’article 855 de la loi précitée. Cette procédure dite « d’urgence » donne au juge saisi qui ne peut être que le président du tribunal ou un juge délégué par lui, l’opportunité d’exercer trois grandes prérogatives dictées par les circonstances : l’ordonnance de mesures conservatoires, la prescription des mesures préparatoires et d’anticipation d’un procès au fond.
A l’analyse de l’article 855 de la loi précitée, il apparait bien que le juge des référés, selon qu’il existe ou non une « contestation sérieuse » peut, en cas de besoin prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent « soit pour prévenir un dommage imminent », soit pour « faire cesser un trouble manifestement illicite » (i). Au contraire, dans l’hypothèse d’une contestation sérieuse, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé (ii).
- La prévention
Aux fins d’obtenir du juge saisi de cette procédure des mesures préventives décidées par ordonnance, l’avocat doit démontrer l’existence d’un dommage imminent et la preuve d’un trouble manifestement illicite.
En ce qui concerne la démonstration d’un dommage imminent, le juge des référés peut intervenir s’il se trouve saisi par le demandeur d’un risque imminent de dommage, c’est-à-dire un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
La mission du juge des référés consiste alors à empêcher qu’une situation irréversible ne se crée, évitant ainsi l’irréparable. L’urgence est donc sous-jacente au dommage imminent, de même que l’illicéité.
A titre illustratif, le juge des référés sera compétent pour ordonner des travaux en urgence, pour éviter l’effondrement d’un immeuble, constituant un péril imminent ou ordonner la suspension de travaux de construction d’un édifice, jugeant que la construction telle qu’entrepris causerait de grave préjudice aux voisinages.
Que ce soit en première instance ou en appel, le juge est tenu de se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
S’agissant de la preuve d’un trouble manifestement illicite, la doctrine la définit comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Le trouble manifestement illicite procède donc de la méconnaissance d’une norme obligatoire. Constituent par exemple un trouble manifestement illicite une discrimination fondée sur l’âge d’un salarié, ou encore, le refus d’un associé de voter une modification de l’objet statutaire de la société l’empêchant de fonctionner conformément à son objet réel
Le cas le plus fréquent du recours au juge des référés sur ce fondement, est celui de l’expulsion d’un immeuble, d’occupants sans droit ni titre.
- La conservation
Les mesures qui peuvent être ordonnées à titre conservatoire sont de deux ordres selon la loi précitée, elles peuvent être : conservatoires et/ou de « remise en état ».
À titre d’illustration, les mesures conservatoires ou de remise en état peuvent être ordonnées afin de prévenir des actes de concurrence déloyale, de suspendre les effets d’un préavis de grève, ou encore d’interdire des opérations commerciales entreprises en violation de la loi.
Parmi les mesures de remise en état, on peut mentionner le retrait d’une affiche de film, l’obligation imposée à l’éditeur d’une revue d’occulter des visages photographiés clandestinement, l’arrêt des émissions d’une radio non autorisée ou des mesures propres à faire cesser la diffusion de propos diffamatoires sur Internet.
On notera qu’il a même été admis sur ce fondement que le juge pouvait ordonner le paiement d’une somme provisionnelle, en dépit de l’existence d’une contestation sérieuse, s’il s’agissait de faire cesser un trouble manifestement illicite (en l’espèce, le non-paiement de salaires).
- Les limites au rôle de l’avocat dans la défense des libertés individuelles et collectives
Le rôle de l’avocat en sa qualité de défenseur des libertés individuelles et collectives n’est pas tout à fait libre de toute entrave légale. Dans l’exercice de son ministère, l’avocat ne doit pas perdre de vue qu’il appartient à un ordre et qu’en tant que tel certaines contraintes qui résultent de son statut doivent être respectées (A) et plus encore, il doit faire preuve de courtoisie dans ses rapports avec les magistrats et autres personnes agissant en vertu d’un pouvoir légal (B).
- Les limites statutaires
Le statut de l’avocat lui impose principalement une obligation au respect du secret professionnel (1) mais aussi le soustraire à tout conflit d’intérêt et risque de conflit d’intérêt dans l’exercice de son ministère (2).
- Le secret comme devoir
Le principe du secret dans l’exercice de la profession d’avocat est celui en vertu duquel les informations recueillies dans le cadre professionnel doivent être sauvegardées et ne peuvent être révélées, sauf circonstances exceptionnelles. Il s’agit d’une exigence d’ordre public, qui a un caractère général, absolu et illimité dans le temps. Il s’impose comme une obligation professionnelle susceptible d’engager la responsabilité civile voire pénale de l’avocat qui s’en écarte.
L’obligation de confidentialité imposée à l’avocat se décline successivement dans ses rapports avec son client, dans ses rapports avec ses confrères et ne couvre pas les rapports du client avec les tiers.
C’est ainsi que l’avocat peut être poursuivi devant les juridictions répressives pour violation du secret professionnel ou encore mieux pour violation du secret de l’instruction et de l’enquête.
- Les conflits d’intérêts
Selon l’article 39 du Règlement n°05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat « l’avocat ne doit être, ni le conseil, ni le représentant, ni le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il existe un risque sérieux de conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée. Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres ».
- Les limites fonctionnelles
De principe durablement établi, les avocats doivent bénéficier « de l’immunité civile et pénale pour toute déclaration pertinente faite de bonne foi dans des plaidoiries écrites ou orales ou lors de leur parution ès-qualité devant le tribunal ou une autre autorité juridique ou administrative ». Toutefois, l’immunité ne joue que dans l’espace de temps des débats judiciaires lorsque les propos tenus par l’avocat n’ont rien d’étranger à la défense qu’il met en œuvre. Un avocat qui sort de son rôle s’expose à des poursuites pour outrage, injure, diffamation (1). Et, c’est la raison pour laquelle il doit aussi prendre de sérieuses précautions dans ses rapports avec les médias (2).
- L’outrage et le discrédit d’une décision juridictionnelle
L’outrage est constitué dès lors que par parole, geste ou menace, écrit ou dessin, envoi d’objet, [toutes personnes ] à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à un magistrat, à une personne siégeant dans une juridiction, à un dépositaire de l’autorité ou de la force publique, dans l’exercice de ses fonctions. Il est de même pour une personne chargée d’une mission de service public. Tout acte entrant dans cette énumération constitue une infraction.
Selon l’article 410 de la Loi n° 2018-16 portant code pénal le discrédit d’une décision juridictionnelle est constitué dès lors que par actes, paroles ou écrits diffusés publiquement, toute personne est convaincue d’avoir « cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance ». Toutefois, le législateur répressif a pris le soin de préciser que les commentaires purement techniques dans les revues spécialisées, ni les actes, paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation, ne peuvent en aucun cas être considérés comme une infraction à la loi pénale.
Toutes ces dispositions de la Loi n° 2018-16 portant code pénal constituent un arsenal répressif suffisamment dissuasif ; la liberté de la défense pouvant s’en trouver fort amoindrie.
- Les médias
La relation entre avocats et médias n’est pas aisée, elle mérite une extrême prudence avec un égard particulier pour le respect de certaines exigences déontologiques en l’occurrence la délicatesse et le devoir de réserve. C’est ainsi que la violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête et de l’instruction, à l’occasion d’une interview repris en boucle dans les médias, peut exposer l’avocat à des poursuites disciplinaires et pénales.
Aussi, est-il important de souligner que les auteurs de commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d’instruction ou de jugement avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive seront punis des peines prévues à l’article 410.
Le législateur répressif béninois est allé plus loin, en transformant la publication par voie de presse comme une circonstance aggravante. Dans cette dynamique, il a prévu que, lorsque l’infraction qualifiée discrédit jeté sur une décision juridictionnelle aura été commise par voie de presse, les dispositions de l’article 455 du code pénale sont applicables et dans ce cas, le délinquant risque un emprisonnement de cinq à dix ans.
Ce sont autant d’éléments que l’avocat devrait évaluer avant de recourir à la presse, ou de l’éviter tout simplement vu que les termes qu’emploient assez souvent les journalistes peuvent être tendancieux et sujet à interprétation, dans le seul dessein de capter l’attention du public, du lecteur en quête d’information.
Conclusion
S’il est possible de concevoir ou de rêver la démocratie et l’Etat de Droit comme des citadelles imprenables ou difficilement attaquables, c’est d’abord et avant tout parce que le métier d’avocat se veut un rempart contre toutes les dérives attentatoires aux libertés individuelles et/ou collectives.
Si la constitutionnalisation des droits et libertés voulus par le constituant béninois du 11 décembre 1990 offre une garantie fondamentale à la protection de certaines libertés et que les lois de la république offre une assurance complémentaire à la préservation desdites libertés, l’avocat encore une fois, prévient de par son statut et rassure de par son action, dans le respect de sa déontologie et ses convictions personnelles et pour l’intérêt exclusif de ces mandants.
Ce statut n’est pas celui d’ « un auxiliaire de justice ». Non ! La justice institutionnelle pouvant être elle-même perçue comme une forme d’oppression justifiée pour la sauvegarde de l’intérêt général, il est plutôt un « auxiliaires des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». C’est d’ailleurs pour cela qu’il peut bénéficier de certains privilèges et immunités
Son action pour le citoyen lambda « est, par nature, désintéressé, ce qui signifie que s’il a le légitime désir de gagner convenablement sa vie, il ne fait pas d’affaires avec ses clients » ; il dépend plutôt, conformément au droit, les affaires de ceux-ci.
Sa déontologie, plus que l’Ordre auquel il appartient, sont ses bouclier dans le combat permanent qui est le sien, pour faire reculer l’arbitraire sous quelques formes sous lesquels il pourrait se dissimuler. Au service de sa cause, il revendique son indépendance, sa compétence et son dévouement. Il est au cœur du secret professionnel le plus absolu, pensé et voulu comme le plus impératif de ses droits et le plus sacré de ses devoirs et, il doit éviter toute situation de conflit d’intérêts manifestement préjudiciable à son client.
Ses convictions personnelles intéressent sa conscience propre, celle-là même qui ne doit tolérer aucune immixtion ou agressions extérieures et qui devrait être respectée quoiqu’elle coute
Pour conclure, j’invite tous mes confrères à méditer cette réflexion de l’écrivain de la négritude Aimé Césaire :
« Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche… Ma voix, la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du désespoir ».
Je vous remercie !